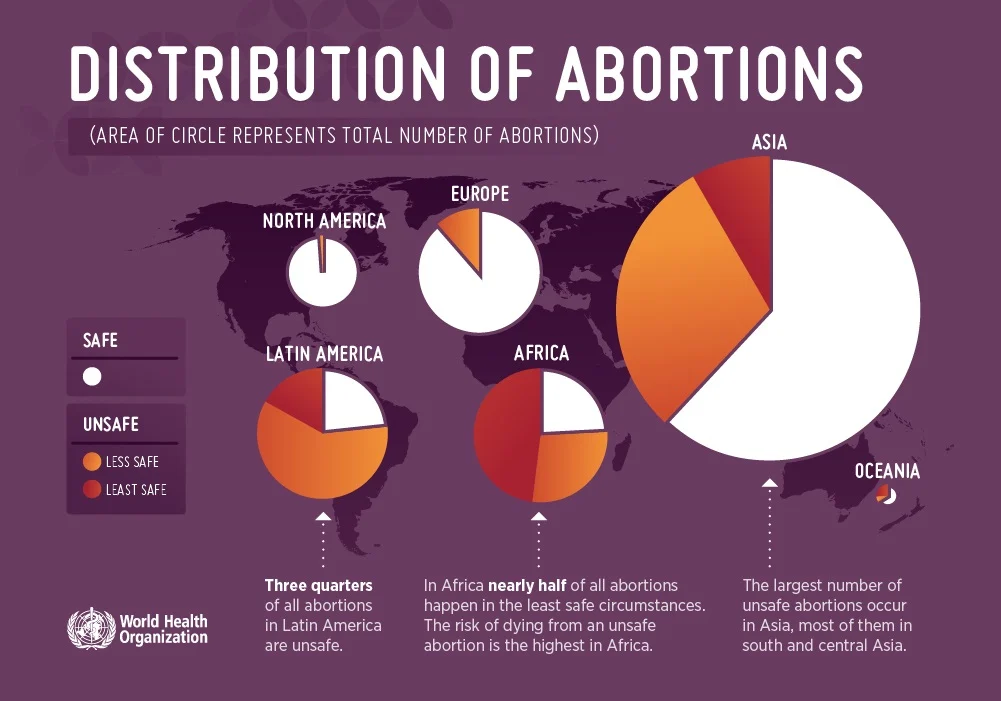Dans le couloir sombre qui longe le service de maternité d’un hôpital de l’est du Rwanda, l’urgence se lit autant dans les pas pressés du personnel que dans le silence des patientes. Toutes les quelques minutes, une infirmière pousse une civière vers la petite salle dédiée aux soins après avortement, un espace dont on parle rarement à voix haute, mais qui porte, en silence, le poids de l’une des crises sanitaires les moins visibles du pays.
A l’intérieur, les gestes médicaux sont précis, presque mécaniques. L’atmosphère, elle, est tout sauf neutre. Des adolescentes tremblent encore, affaiblies par l’hémorragie. D’autres gardent les yeux fixés au sol, redoutant les interrogations qu’elles connaissent déjà : « Qu’est-ce qui s’est passé ? Pourquoi n’es-tu pas venue plus tôt ? » La plupart ne répondent jamais.
Un drame discret derrière les murs des hôpitaux
Un mercredi matin, une jeune fille de 17 ans, son identité est protégée, arrive inconsciente après avoir tenté d’interrompre sa grossesse à l’aide d’herbes conseillées par une amie.
« Quand elle est arrivée, l’infection avait déjà gagné tout l’utérus », raconte Speciose Mukabutera, sage-femme depuis 11 ans. « Nous l’avons sauvée, mais certaines n’y parviennent pas. Beaucoup arrivent trop tard, la peur les retient. »
Peur du regard des parents. Peur des enseignants. Peur d’être jugée. Peur, parfois, d’être simplement vue en train d’entrer dans un centre de santé.
Pourtant, la loi rwandaise autorise l’avortement dans des circonstances précises : viol, inceste, risques pour la santé de la mère ou anomalies fœtales. Le gouvernement a multiplié les initiatives en santé sexuelle et reproductive (SSR), incluant la Politique nationale de santé reproductive (2019), des programmes dédiés aux adolescents et des services de soins post-avortement dans tout le pays.
Mais aucune loi ne peut faire taire les chuchotements, ni briser les tabous qui règnent dans les foyers.
« Je croyais que ma vie était finie »
Clarisse Niyonsaba n’avait que 18 ans lorsqu’elle a découvert sa grossesse. À 22 ans aujourd’hui, elle se souvient encore de la panique qui l’a envahie.
« Pendant des mois, je n’ai parlé à personne. J’avais peur… surtout parce que je ne savais rien sur la grossesse », confie-t-elle. « À l’école, on n’aborde pas ces sujets. À la maison non plus. »
Elle a tenté des méthodes clandestines pour “mettre fin au problème”, avant que des complications ne la conduisent d’urgence à l’hôpital. Clarisse a survécu. Beaucoup d’autres n’ont pas cette chance.
Des voix qui s’expriment encore dans l’ombre
Dans un centre pour jeunes du district de Muhanga, un groupe d’adolescentes accepte de parler anonymement.
« Dès qu’une fille tombe enceinte, les gens la condamnent immédiatement », explique l’une d’elles, 16 ans. « Même aller demander un conseil sur la contraception fait de toi une coupable. »
Une autre, 19 ans, qui a accompagné une amie vers une tentative d’avortement clandestin, ajoute :« Certaines choisissent entre deux peurs : mourir… ou être vues en entrant dans une clinique. Le stigmate est plus fort que le danger. »
Beatrice Uwimana, mère de trois filles, reconnaît sa part de responsabilité :« Nous avons grandi dans le silence, alors nous reproduisons ce silence. Mais maintenant, je vois que cela détruit nos enfants. Elles ont besoin des conversations que nous n’avons jamais eues. »
Quand l’information manque, les méthodes dangereuses prolifèrent
Médecins et infirmières voient défiler des cas de plus en plus inquiétants : herbes toxiques, objets tranchants, médicaments pris en surdosage et achetés clandestinement.
« Quand elles arrivent, l’utérus est parfois perforé ou l’infection a déjà atteint le sang », déplore le gynécologue Jean Paul NAMAHORO, de Kigali. « Ce sont des décès évitables. Les soins post-avortement existent. Ce qui manque, c’est l’accès précoce et la confiance. »
Carine Gihozo, experte en santé des adolescents dans une ONG nationale, va plus loin :« Une loi ne change pas les mentalités. Expliquer n’est pas encourager l’immoralité : c’est sauver des vies. »
Dans un lycée de Nyagatare, un enseignant , qui requiert l’anonymat , raconte :« Des filles disparaissent soudainement des cours. Quelques semaines plus tard, on entend qu’elles ont frôlé la mort. Nous n’avons pas d’éducation structurée en SSR. Le silence, encore une fois, fait son œuvre. »
Des pistes pour briser le cycle
Selon plusieurs professionnels, la solution passe par une approche intégrée combinant dialogue, éducation et confiance. Le gynécologue Jean Paul Namahoro estime que « créer des espaces pour jeunes sans jugement et offrir une information claire peut transformer la manière dont les adolescentes cherchent de l’aide ». L’experte Carine Gihozo renchérit : « L’éducation à la santé sexuelle doit commencer tôt, à l’école comme à la maison. Les parents ont un rôle irremplaçable. » Pour sa part, le spécialiste des politiques publiques Karahamuheto Jeff souligne l’importance « d’élargir les plateformes numériques destinées aux jeunes et de sensibiliser davantage sur les dispositions légales en matière d’avortement sécurisé ». Un consensus se dégage : la prévention ne dépend pas seulement des structures médicales, mais de toute la société.
Un cadre légal solide, mais une réalité encore fragile
Le Rwanda s’est doté d’un arsenal juridique robuste. Le Code pénal de 2012 a ouvert la voie à l’accès légal à l’avortement dans des cas spécifiques. La Politique nationale de santé reproductive (2019) garantit l’accès équitable à l’information et aux services. La Stratégie nationale en santé sexuelle et reproductive des adolescents vise, elle, à ne laisser aucun jeune de côté. Les soins post-avortement sont disponibles dans l’ensemble des hôpitaux et centres de santé publics.
Mais comme le résume Karahamuheto Jeff :« Le défi, c’est de transformer des protections écrites dans la loi en protections ressenties dans la vie quotidienne. Pour cela, il faut de la compassion, de la sensibilisation et une lutte sans relâche contre le stigmate. »